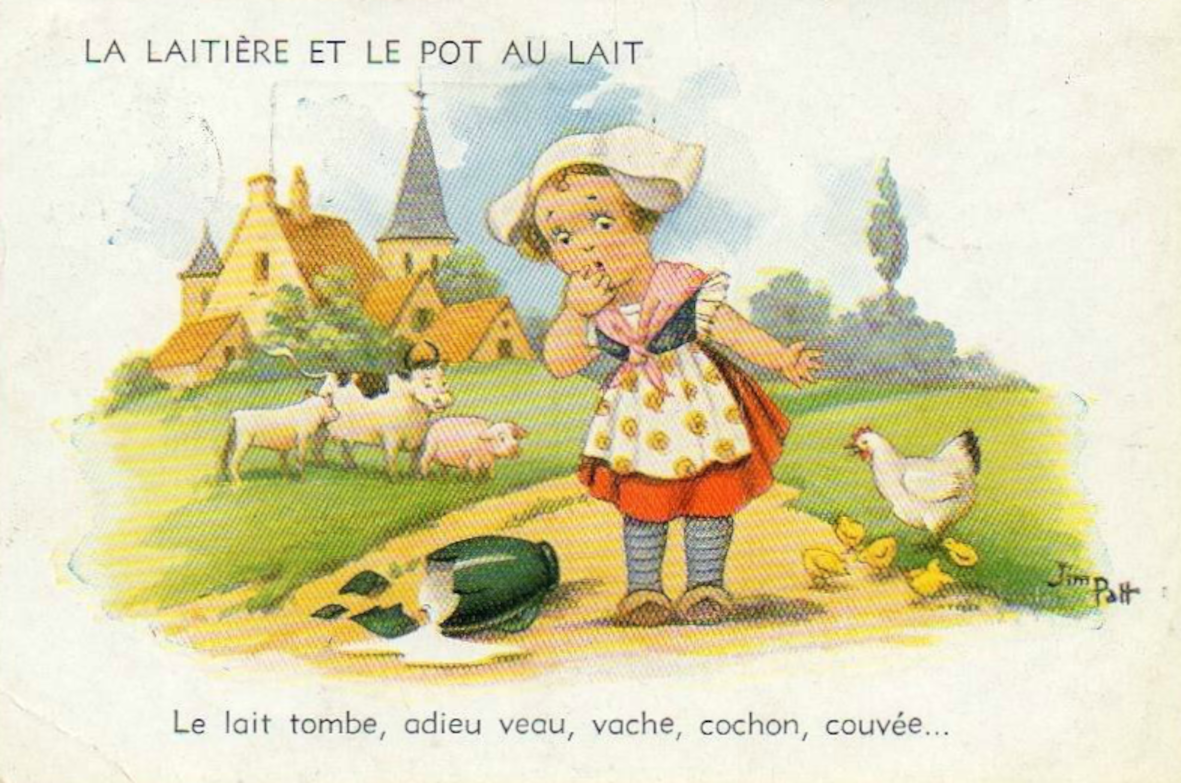L’anthropologie du libéralisme est à la fois pessimiste, désespérée, en même temps qu’elle affiche un optimisme radical de la raison. L’invention de l’homme par l’homme. (Michéa, in Le complexe d’Orphée)
Dans l’attente de la transgression qui ferait régresser le progressisme !
J’ai, sinon changé, au moins modifié, mon plan de presentation. J’aimerais aujourd’hui citer un passage du livre de Jean-Claude Michéa (2023), Extension du domaine du capital, et des idées prise à la lecture d’un autre de ses livres (2018), Le loup dans la bergerie, dont le slogan de la bande-annonce prévient : « Qui commence par Kouchner finit toujours par Macron ».
Le livre de Trenkle et Lohoff dont il est question dans l’extrait : La Grande Dévalorisation. 2014. Post-éditions.
Michéa nous mentionne que le point de départ (simplifié) de leur argumentation c’est la « théorie du “capital fictif“ que Marx avait commencé à développer dans le livre III du Capital pour rendre compte aussi bien de la monnaie de crédit que des titres de la dette publique et du système des actions. Ce qui autorisait Marx à rassembler ainsi sous un concept unique ces trois types de produits financiers différents, c’est le fait qu’ils représentent tous, pour reprendre la définition de Cédric Durand, des « droits de tirage sur de la valeur qui reste à produire » (Le capital fictif. Comment la finance s’approprie notre avenir, Les prairies ordinaires, 2014, p. 10). » (Michéa, 2023.167-168).
Or les chiffres parlent ici d’eux-mêmes. En 1989, rappellent par exemple Trenkle et Lohoff, la capitalisation boursière mondiale de toutes les entreprises officiellement cotées ne représentait encore que 42 % du PIB mondial. Quelques années plus tard, en 1997, ce pourcentage était déjà monté à 64 %. Et en 1999, pour la première fois dans l’histoire du mode de production capitaliste, la capitalisation boursière mondiale devenait supérieure au PIB cumulé de toutes les nations de la planète. Processus naturellement devenu, depuis lors, exponentiel et inarrêtable, comme le prouve clairement le fait qu’en 2012 – date à laquelle le livre de Trenkle et Lohoff était publié en Allemagne – le volume global de ces anticipations spéculatives de la richesse à venir (quelle que soit la forme concrète – actions, produits dérivés, titres de la dette publique, etc. – de ce capital fictif global) était désormais plus de vingt-quatre fois supérieur à celui de la production matérielle réelle de l’économie capitaliste mondiale (un déséquilibre structurel qu’on retrouve d’ailleurs logiquement à l’échelle de chaque entreprise phare du capitalisme contemporain, comme le confirme, ici encore, le fait que la capitalisation boursière d’Apple, de Microsoft ou de Google – pour ne prendre que ces trois exemples emblématiques – est déjà aujourd’hui inversement proportionnelle au nombre de salariés qu’elles emploient réellement). Mais cela signifie aussi – si du moins on conserve encore un minimum de bon sens – que même dans l’hypothèse où la journée de travail serait portée à 18 heures, la retraite à 90 ans et les congés payés définitivement abolis (Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et leurs amis de McKinsey y ont certainement déjà 174 songé), une telle pyramide, sans cesse croissante, de dettes (ou, si l’on préfère, une bulle spéculative mondiale d’une telle ampleur) n’a évidemment plus la moindre chance de se voir remboursée un jour (sauf à croire au miracle d’une création ex nihilo perpétuelle par les banques centrales ou au « trillon dollar coin» de Barack Obama et Joe Biden). La conclusion que Trenkle et Lohoff en tirent est donc imparable. « Le « capitalisme inversé », écrivent-ils ainsi (p. 280), représente une sorte particulière de pyramide de Ponzi. Plutôt que de répartir de la richesse déjà existante, il a pour contenu l’anticipation de production de valeur future. Pour pallier l’absence de production de valeur auto-entretenue, la production de titres de propriété qui nourrit cette anticipation doit s’accroître sans trêve. Tant que d’une période à l’autre la masse de capital fictif s’agrandit suffisamment, et que les bulles qui ont éclaté sont immédiatement remplacées par de nouvelles encore plus grandes, le capitalisme inversé reste stable. Mais que la nouvelle production de titres de propriété tourne sérieusement court et que l’ensemble de la production de l’industrie financière se contracte, non seulement à court terme, mais aussi sur une période plus longue, et le système dans son ensemble s’effondre. Le capitalisme inversé se dirige inéluctablement vers ce point. »
En vérité, on peut même avancer sans risque de se tromper qu’au point d’évolution que le nouveau capitalisme « inversé » a d’ores et déjà atteint, seule une nouvelle forme de guerre mondialisée – et, dans l’idéal, de « moyenne intensité », au moins pour les États-Unis et les pays occidentaux – pourrait éventuellement ralentir, voire suspendre un certain temps, cette fuite en avant suicidaire du capitalisme financiarisé et mondialisé. Mais j’imagine, là encore, que le Pentagone et l’OTAN y ont déjà longuement réfléchi. (Michea, 2023 :174-175).
Lecture du dernier paragraphe qui précède, voilà que reviennent dans mon souvenir des discussions entendues dans le bistrot de mes parents, en particulier lors de la naissance du mouvement de Poujade, L’Union de Défense des Commerçants et Artisans (UDCA). Des « vieux », de l’âge de mon grand-père, qui avait connu 1914-1918 et 1939-1945, au bout d’un moment de discussion, évoquaient, dans un soupir : « une bonne guerre, ça ferait du bien ! ». Ils fabriquaient ainsi leur point Godwin « de proximité ».
À ce niveau de cynisme on pourrait se surprendre à voir Poutine comme un sauveur du capitalisme, offrant au néolibéralisme une opportunité de retarder sa mort – un peu comme ces malades, victimes d’un cancer du pancréas au stade terminal, se prenant à espérer dans le médicament qui prolongera leur vie d’une semaine.
« L’économie c’est la méthode. Mais notre but reste de changer le cœur et l’âme de l’être humain. »
Margaret Thatcher(Sunday Times, 3 mai 1981) Cité par J.-C. Michéa, en exergue à Notre ennemi le capital (2017).

© Mutio
À défunt justifiant les moyens : « Qui prolonge l’agonie, retarde les frais de cérémonie ».
Aymé Shaman, ISO 14’000.